Histoire de l’école du Centre Dramatique de l’Est par Evelyne Ertel
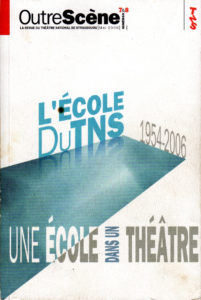 « Histoire d’une Ecole » par Evelyne Ertel, in OutreScène, La Revue du Théâtre National de Strasbourg, mai 2006.
« Histoire d’une Ecole » par Evelyne Ertel, in OutreScène, La Revue du Théâtre National de Strasbourg, mai 2006.
Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris III-Sorbonne Nouvelle, historienne du théâtre, dramaturge, elle a écrit de nombreux ouvrages sur le théâtre. Dans ce texte elle dresse la première histoire de l’Ecole qui, portée par le succès de la décentralisation, puis secouée par ses crises, n’a cessé d’être traversée par l’histoire du théâtre public en France. Elle montre comment les enjeux artistiques, pédagogiques et politiques y sont indissociables depuis sa création, par Michel Saint-Denis, il y a plus d’un demi-siècle.
Article publié in OutreScène, La Revue du Théâtre National de Strasbourg, mai 2006, « L’Ecole du TNS, 1954-2006, Une école dans un théâtre », pp. 158-182.
Histoire d’une École
Neveu et disciple de Jacques Copeau, Michel Saint-Denis accepte de prendre en 1953 la direction du Centre dramatique de l’Est, à la seule condition que les subventions accordées par l’État et les municipalités lui permettent de créer, à côté du théâtre et en relation avec lui, une école « supérieure », formant à tous les métiers du théâtre. Car il a fait sien le principe de Copeau qui, en fondant le Vieux-Colombier, affirmait : « L’idée de l’École et l’idée du Théâtre ne sont qu’une seule et même idée. Elles sont nées ensemble. ». Principe d’interdépendance qui a, pendant plus de cinquante ans, assuré la continuité de l’École de Strasbourg, malgré les remous et les crises qui ont pu la secouer, quels qu’aient été les évolutions de la pratique théâtrale, les flux et reflux des idéologies et des esthétiques, et qui fait encore aujourd’hui sa spécificité.
Une même souche : Copeau
La fondation de cette école est liée à l’histoire de la décentralisation dramatique en France, qui, elle-même, s’est inspirée très largement des idées de Copeau, tant sur le plan esthétique que sur le plan éthique :
– mise en place d’un répertoire à la fois éclectique et cohérent, équilibrant classiques et modernes, français et étrangers ;
– mise en scène subordonnée au texte dramatique, reposant essentiellement sur le jeu des acteurs, d’où l’importance accordée à la formation ;
– économie des autres moyens scéniques (le fameux « tréteau nu ») ;
– primauté de l’ensemble sur l’individu, d’où la nécessité de la troupe permanente ;
– valorisation des qualités morales de l’acteur plutôt que de ses dons.
Premier Centre dramatique créé en 1946, le CDE est né de la volonté conjuguée de plusieurs villes de l’Est de la France réunies en un Syndicat intercommunal (Colmar, Strasbourg, Metz, Mulhouse et, à partir de 1951, Haguenau) et de l’État, en la personne de Jeanne Laurent : l’Alsace ayant subi pendant l’Occupation une germanisation forcée, l’implantation d’une troupe « stable » qui rayonnerait dans les villes de la région, en y donnant « des représentations théâtrales de qualité élevée » semble un bon moyen de rendre sa primauté à la langue et à la culture françaises. Pour assurer cette « qualité élevée », le Centre se donne aussi d’emblée comme but « la formation éventuelle de comédiens ». Ceci doit se comprendre par rapport à la situation de l’époque : la quasi-totalité de la vie théâtrale professionnelle se déroule à Paris – la province n’en connaît que ce que lui en apportent des tournées ponctuelles – et, en particulier, ce n’est qu’à Paris que le futur acteur peut apprendre son métier. On comprend qu’ait été ressentie la nécessité de former, pour la troupe locale, des acteurs « issus de la région », au même niveau de compétences que leurs collègues parisiens.
Ce projet est clairement formulé dans la lettre de candidature à la succession de Roland Piétri – celui-ci a assuré une première direction de quelques mois – qu’André Clavé adresse à Jeanne Laurent en avril 1947 : « Un Centre ne saurait vivre sans une école où les candidats comédiens de la région puissent faire leur apprentissage, et où les comédiens de la troupe devraient eux-mêmes venir se perfectionner et réfléchir sur leur métier ». Peu après sa prise de fonction à la tête du CDE, Clavé fonde effectivement l’École d’art dramatique du CDE (E.C.D.E.), qui se tient au théâtre municipal de Colmar – siège provisoire du Centre avant que la construction d’un nouveau théâtre lui permette de s’installer à Strasbourg. Des cours gratuits de deux heures ont lieu en fin de journée, assurés par « certains membres de la troupe permanente » ; le programme annoncé est le suivant : improvisation mimée, étude de scènes, diction, littérature appliquée, danse, gymnastique, scénographie, chant et pose de voix. On ne sait pas exactement comment cette école a fonctionné, ni dans quelle mesure son programme plutôt ambitieux a pu être rempli. Elle n’avait certainement pas les moyens de ce à quoi elle prétendait : «former de jeunes élèves comédiens qui pourront être appelés à participer à l’effort artistique actuel et futur du CDE » .
Mais il est intéressant de souligner que pour Clavé, au moins sur le plan théorique, il ne s’agit pas simplement de combler un manque : la formation professionnelle de l’acteur doit être liée à « une éthique nouvelle »; l’École doit former des « militants » ; elle « est un laboratoire où l’on cherche, où l’on élabore, où l’on combat ». Par ces termes, où l’on peut aussi déceler l’influence des mouvements de l’Éducation populaire, il se revendique clairement de Copeau ; c’est, du reste, une citation de celui-ci qu’il met en exergue à sa présentation de l’École.
Sans avoir jamais eu de lien direct avec le fondateur du Vieux-Colombier, Clavé est bien de sa lignée, par la médiation de Jouvet et de Dullin qu’il admire. Déjà, plusieurs des membres de la compagnie itinérante La Roulotte, qu’il a fondée et dirigée pendant l’Occupation, venaient de l’Atelier, notamment Jean Vilar qui co-animait la troupe et Hélène Gerber, engagée comme comédienne au CDE et à qui il confie la responsabilité de l’École. La troupe permanente qu’il constitue est formée principalement par d’anciens élèves et comédiens de Dullin. À son départ du Centre, Michel Saint-Denis lui rend hommage en reconnaissant cette filiation : « André Clavé et moi nous sommes issus de la même souche ».
De cette souche, Saint-Denis est certainement le rejeton le plus direct. Jeune homme, il rejoint l’aventure du Vieux-Colombier en 1919 lorsque Copeau rouvre son théâtre après la guerre. Il y participe en tant que secrétaire général et, après le départ de Jouvet en 1922, comme régisseur. Il assiste à toutes les répétitions, observe le travail du metteur en scène et du directeur d’acteur, admire sa façon de « s’approcher du texte, de l’apprivoiser sans jamais s’en rendre maître à l’excès » s’imprègne des idées et des méthodes de Copeau, notamment en ce qui concerne l’École, laquelle, annoncée dès 1913, n’est mise en place qu’en 1920. En décidant la fermeture du Vieux-Colombier en 1924 et la « retraite » en Bourgogne, Copeau choisit l’École contre le théâtre et la province contre Paris. L’École conçue non pas seulement comme lieu de formation, mais comme « terrain d’expérience », « laboratoire d’essai ». Saint-Denis fait partie du groupe de disciples (comédiens et anciens élèves) qui font assez confiance au « Patron » pour le suivre et chercher avec lui, dans l’isolement et l’austérité, dans le désintéressement absolu, par un travail « pur et sans entraves » à faire naître « un art dramatique neuf ». Participant comme acteur-animateur à toute l’aventure des Copiaus, qui est considérée historiquement comme la première expérience de décentralisation théâtrale, Saint-Denis explore par la pratique toutes les facettes de l’improvisation, du masque, du jeu choral, découvre les vertus de l’entraînement corporel (gymnastique, danse, chant) et d’une « bienfaisante discipline ». Toutes choses que l’on retrouvera dans chacune des écoles qu’il sera amené à fonder par la suite.
Lorsque Saint-Denis prend la direction du CDE, il est riche d’une double expérience en ce domaine. Tout en poursuivant à Londres une carrière de metteur en scène entamée en France avec sa Compagnie des Quinze (1931-34) – il monte notamment Macbeth avec Laurence Olivier dans le rôle-titre et Les Trois sœurs avec John Gielgud, Peggy Ashcroft, Alec Guiness… – , il a créé et dirigé à Londres de 1936 à 1939 The London Theatre Studio (LTS), puis, après la guerre, The Old Vic School (1947-52) au sein de l’Old Vic Theatre Centre. Avec la première école, il commence à tester les méthodes de formation qui seront développées et exploitées par la suite : notamment, il expérimente le « système » de Stanislavski (il publie en anglais un fragment de La Formation de l’acteur). Dans la seconde, fondée avec George Devine et Glen Byam Shaw et soutenue par Laurence Olivier, il met en place un double cursus progressif, l’un de jeu, l’autre technique ; faute de moyens suffisants (aucune subvention publique), le cursus n’était que de deux ans alors que Saint-Denis l’aurait souhaité de trois. À l’issue de leur training, acteurs et décorateurs-techniciens étaient appelés à former une troupe, The Young Vic, dont la mission était de tourner le ou les spectacle(s) répétés à l’École. Les meilleurs des élèves techniciens étaient invités à poursuivre une formation d’un an à la mise en scène – ce qui était totalement nouveau en Angleterre. L’Old Vic School, contrainte, malgré son incontestable succès (plusieurs centaines de candidats et une centaine d’élèves par an), de fermer pour des raisons financières après cinq ans, servit de modèle et de référence à l’école que Saint-Denis allait mettre en place au CDE, d’abord très modestement, mais pour longtemps, et avec un rayonnement sans cesse grandissant.
Renouveler l’art dramatique
Plus passionné par la formation que par la mise en scène et affaibli par une première attaque cérébrale, Saint-Denis aurait souhaité que Clavé gardât la direction du Centre, pour se consacrer entièrement à « l’École professionnelle ». Mais devant le refus de Clavé d’accepter ce partage, il doit prendre en charge la responsabilité de l’ensemble et devient, statutairement, « directeur général » du CDE et de « l’École d’art dramatique annexée au Centre », liaison désormais organique qui ne sera jamais démentie. Parce qu’il est tenu d’assurer prioritairement la saison 1953, l’École n’ouvrira ses portes qu’en janvier 1954, encore dans des locaux provisoires à Colmar, ceux prévus à Strasbourg n’étant pas achevés.
Pourtant c’est bien à l’École qu’il pense et dont il espère le plus dès le début. Dès février 1953, il affirme, comme son prédécesseur, que l’École doit former des artistes régionaux pour le Centre, mais il lui donne une ambition beaucoup plus vaste : elle ne doit pas se contenter d’être « provinciale », « elle doit viser à un niveau international » en recrutant des étudiants venus de toute la France et même de l’étranger, car c’est par la confrontation la plus diverse qu’elle atteindra une qualité élevée : de fait, dans les premières années, il y aura un certain nombre d’élèves ou d’auditeurs étrangers. Mais pour lui comme pour Copeau, la formation n’est pas une fin en soi, l’École est conçue comme un « laboratoire », elle doit être le lieu privilégié de recherches qui serviront à faire évoluer le théâtre dans son ensemble. C’est par là que la province se haussera au niveau de Paris et qu’il aura atteint son but : « faire de la région de l’Est l’une des sources de l’art dramatique français » .
En attendant, les débuts de l’École sont plutôt difficiles. Les douze élèves comédiens qui forment le premier Groupe n’ont pas été recrutés aisément : les candidats se font rares et leur niveau est souvent insuffisant. De fait, Saint-Denis, après son séjour de dix-sept ans en Angleterre, est quasiment inconnu en France (encore aujourd’hui, il est beaucoup plus célèbre dans les pays anglo-saxons que chez nous). D’autre part, les locaux qui devaient accueillir l’École à Strasbourg ne sont toujours pas prêts (le transfert ne pourra être effectué qu’en octobre 1954). Pour ces deux raisons, la rentrée qui devait se faire en octobre 1953 est reportée pour les comédiens à janvier 1954 ; quant au groupe d’élèves techniciens, il ne débutera qu’en décembre 1954. Leur cursus s’en trouvera donc écourté.
En revanche, le programme de l’École et les principes qui le sous-tendent sont clairement établis par Saint-Denis. D’abord, il a obtenu que son intitulé comprenne le qualificatif « supérieure », ce qui signifie qu’elle n’a pas vocation à s’adresser à des débutants (comme les Conservatoires municipaux) et ce qui la met sur un pied d’égalité avec le Conservatoire Supérieur de Paris – seule école nationale jusque-là : elle est donc totalement gratuite et les élèves les plus modestes peuvent obtenir des bourses d’état, comme les étudiants. Elle est « professionnelle », c’est-à-dire qu’elle vise à former des gens de théâtre complets (même s’ils sont spécialisés comme acteurs, décorateurs, régisseurs, metteurs en scène) ; pour cela, il est nécessaire que les élèves comédiens suivent un cursus de trois ans à temps complet, les régisseurs et décorateurs de un à deux ans, voire de trois pour un tout petit nombre d’élèves qui auront montré des dispositions pour la mise en scène. De toute façon, pour que l’enseignement soit profitable, le nombre d’élèves reçus au concours d’admission doit rester limité : autour d’une douzaine pour la section Jeu, autour d’une dizaine maximum pour les cours techniques se subdivisant en deux : section Régie-Mise en scène et section Décoration. Pour renforcer les liens entre le théâtre et l’École, Saint-Denis aurait souhaité que des acteurs de sa troupe assurent des tâches d’enseignement (seule Annie Cariel le fit) ; mais leur manque de familiarité à ses méthodes, et le fait qu’ils étaient presque constamment en tournée l’amenèrent à faire venir de Londres ses anciens collaborateurs de l’Old Vic School : d’abord, Suria Magito, sa compagne et future femme, danseuse d’origine russe, à qui il confia la direction de l’École ; Jani Strasser (chanteur d’opéra) pour la voix et le chant, Barbara Goodwin (ancienne danseuse) pour tout ce qui était éducation corporelle et danse ; puis, un peu plus tard, John Blatchley et Pierre Lefèvre, qui s’occupaient d’improvisation et d’interprétation. Saint-Denis lui-même, semble-t-il, avait trop à faire avec l’organisation du théâtre dans son ensemble et la mise en scène des spectacles pour participer aux cours. Mais il présidait avec rigueur le collège des professeurs devant qui, deux fois par trimestre, les élèves présentaient leur travail, et commentait ce qu’il avait vu avec une grande précision, ainsi que le faisait après lui chacun des enseignants. Si les remarques sont parfois sévères, elles sont faites en tenant compte du cheminement propre à chaque élève, dans le but de le faire progresser, non de le décourager. « C’était l’avantage de former vraiment une équipe de pédagogues », commentera plus tard Pierre Lefèvre : cela permettait un « esprit de critique constructive ». Le règlement prévoit que les élèves peuvent être sanctionnés par un renvoi, à la fin, soit du premier trimestre, soit de la première année, si le travail ou les progrès sont jugés insuffisants. Les dossiers des élèves conservés dans les archives du TNS montrent qu’il y eut, au moins jusqu’au début des années soixante-dix, de fréquentes exclusions.
L’originalité des présentations était que, contrairement à ce qui se pratiquait à l’époque au Conservatoire National et dans les tous les cours d’art dramatique, l’élève n’y passait jamais une scène isolée, c’étaient toujours des présentations collectives d’une pièce entière ou de plusieurs actes d’une même pièce, ou des montages à partir de danses, de chansons et d’improvisations (dans le style des spectacles des Copiaus). Car il s’agit de travailler à la fois au développement personnel de chaque individu et à la création d’un « ensemble » – notion centrale de la pédagogie de Saint-Denis et son apport sans doute le plus fécond et le plus durable. Le travail répété au long du cursus sur des spectacles qui réunissent les élèves d’une même promotion (acteurs, décorateurs, régisseurs) permet de constituer le Groupe – ce nom est préféré à celui de « classe » en usage au Conservatoire – en petite compagnie ayant chacune son identité propre. Aboutissement logique : à l’issue de l’École, former une vraie troupe, professionnelle cette fois ; ce qui se fera dès que le Groupe I arrivera en fin d’études, avec la création en 1956, des « Cadets du CDE», dont René Fugler retrace l’histoire dans ces pages.
Un autre principe essentiel de cette pédagogie est que l’enseignement y est progressif et cohérent. Cohérent, parce qu’il s’articule en trois parties : une culturelle, une autre technique et la troisième, qui est la principale, concernant l’improvisation et l’interprétation. Progressif, en ce sens que durant la première année et la moitié de la deuxième, on privilégiera les acquisitions techniques (voix, diction, corps, masque, improvisation) et les cours de culture générale (le tout étant abordé toujours d’un point de vue théâtral et non scolaire). Mais la technique n’est pas une fin en soi, elle est au service de l’interprétation : l’improvisation – dont le training est lui-même progressif – développe l’imagination et la créativité, l’usage du masque favorise la concentration et l’extériorisation des moyens d’expression, il permet d’échapper à la reproduction naturaliste. Aussi la journée est-elle divisée en deux : cours techniques le matin, travail d’interprétation des œuvres l’après-midi. Celle-ci se fait sous la direction d’un des enseignants, car l’acteur doit apprendre à travailler sous la direction d’un metteur en scène, à comprendre ses idées, son point de vue : de cela dépend l’unité de la représentation. L’enseignement ne doit jamais être conduit à partir d’un système ou en vue d’un système. C’est pourquoi, au cours du cursus, une très grande variété de styles de pièces devra être travaillée, avec le principe que l’auteur est le seul vrai créateur et que tous les praticiens (metteur en scène, décorateur, acteur) sont au service du texte.
Si l’intégration de l’École au sein d’un théâtre permet aux élèves techniciens des contacts enrichissants avec les professionnels, les élèves comédiens ne seront pas admis à jouer dans les spectacles avant la fin de leurs études, car il faut préserver le temps de leur développement et ne pas chercher à obtenir des résultats trop rapides. Pendant les deux premières années, les présentations ont lieu uniquement devant un public interne (professeurs et élèves). Ce n’est qu’à la fin du cycle que les élèves pourront montrer leurs spectacles en public, sous la bannière des « Cadets du CDE », en tournée dans la région puis à Strasbourg : le contact avec des publics et des lieux différents leur permettra d’affronter les conditions réelles de l’exercice du théâtre. Après ces représentations, ils reviennent à l’École pour préparer le concours de sortie (qui peut aussi comporter des scènes tirées des pièces présentées en tournée), où sont décernés des prix et auquel sont conviés des metteurs en scène et des directeurs de théâtre venus de Paris ou du reste de la France – ce sera de plus en plus le cas avec le temps : une chance pour les élèves sortants de se voir offrir un engagement. Mais si l’École doit se préoccuper de l’avenir professionnel de ses étudiants – un certain nombre intègrera la troupe du Centre (dès la première sortie en 1956, Claude Petitpierre et André Pomarat) –, elle ne doit en aucun cas se transformer en agence d’emploi.
Quand, en 1957, Saint-Denis se voit contraint, pour des raisons de santé, de renoncer à la direction du CDE, l’École est établie sur des bases si solides qu’elle peut sembler globalement être restée identique jusqu’à aujourd’hui. De fait, tout au long de son histoire, on retrouve les mêmes principes fondamentaux : sa double spécificité d’être partie intégrante d’un théâtre et d’être multidisciplinaire ; le recrutement par concours deux ans sur trois d’un nombre très limité d’élèves (sans condition de nationalité) ; le fonctionnement de chaque promotion en groupe interdisciplinaire ; la division en cours techniques de base et réalisation de spectacles ; l’ouverture progressive au sein du cursus des spectacles au public ; l’obligation pour les élèves de participer à plein temps à tous les cours et ateliers, sans dérogation possible pour une quelconque activité professionnelle extérieure ; l’intégration à la troupe du théâtre (ou à l’équipe) d’anciens élèves ; enfin, même si d’autres formes ont pu être expérimentées, le travail est toujours resté prioritairement centré sur l’interprétation du texte dramatique.
Mais il n’en est pas moins vrai que, malgré sa position géographique excentrée, sa réclusion volontaire, l’École n’a pu – ni souhaité sans doute – se tenir comme un îlot coupé du monde : ses enjeux ont fluctué selon les périodes, déterminés en partie par l’évolution de l’histoire et du théâtre, aux niveaux français et international, en partie aussi par la personnalité, les idées et les pratiques de ses directeurs successifs.
